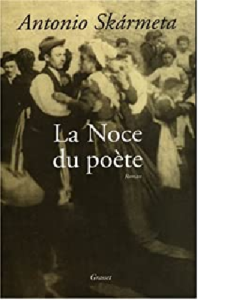 Voici un texte qui décrit une danse assez …. osée.
Voici un texte qui décrit une danse assez …. osée.
Extrait de A.Skàrmeta , La Noce du poète (traduit de l’espagnol), Paris, Grasset, 1999. J’ai trouvé ce livre par hasard (à ma bibliothèque de quartier, où je ne trouve jamais vraiment ce que je cherche mais d’où j’emporte toujours quelque chose). Je n’ai pas trouvé ce bouquin passionnant et je signale aux éventuels amateurs de turumba et autres galipettes que le reste du livre n’est pas du même registre que cet extrait.
Marie-Louise Carels
Sur la Côte de Malice, la danse de fête par laquelle on célèbre traditionnellement toute grande occasion (et le mariage de don Jeronimo et d’Alia Emar méritait bien plus qu’une expression aussi mesurée) s’appelle la turumba, rythme allègre sur lequel les danseurs évoluent selon deux styles différents.
Il Y a d’abord la danse de salon – la turumba proprement dite-, où pianos et violons commencent par suivre la mesure d’une musique aimable et primesautière, dont ils attaquent la mélodie à un tempo raisonnable avant d’accélérer la cadence et de monter en volume sonore, presque à la manière des danses gitanes, mais avec cette particularité que, très rapidement, les hommes se glissent derrière leurs cavalières, les saisissent par la taille, et, avec des va-et-vient qu’ils apprennent dès l’école primaire, effectuent des ondulations scandées de coups de reins sur un mode tout à fait inhabituel dans les contrées d’Europe, d’Afrique et même d’Amérique du
Sud.
L’autre version de la turumba est celle que l’on nomme par euphémisme la « lupanaresque ». Mais dans le langage courant, les gens l’appellent plutôt la « turumpute ». Les fêtes locales commencent par la version la plus modérée, puis, en fonction de la générosité bachique des amphitryons et de la température de la soirée, celle-ci dérive dans quatre-vingt-dix pour cent des cas vers le style le plus libéral. Ainsi, par exemple, les messieurs qui dansent la turumputa promènent leurs mains de la taille à la poitrine de leurs partenaires. Celles-ci, compréhensives, ont préalablement fait un détour par les toilettes pour retirer leur soutien-gorge, de manière que rien ne vienne entraver la spontanéité du contact. A leur tour, les hommes arrachent les petites culottes de ces dames comme dans une conquête de trophée destinée à enfiévrer encore la turumputa -danse aujourd’hui considérée comme un trésor du patrimoine folklorique-, glissent l’objet de leur larcin entre leurs dents et mettent ensuite un entrain toujours croissant à frotter leurs bassins contre les fesses dénudées des belles insulaires, tandis que pianos et violons se déchaînent jusqu’au paroxysme.
Si la fête remplit certaines exigences, alors la turumputa culminera inéluctablement dans une chorégraphie consistant, pour les hommes, à brandir les culottes des dames et à les agiter en l’air comme pour saluer un ami dont le train s’éloigne, cependant qu’ils martèlent le plancher de violents coups de talons; et pour leurs cavalières -protégées peut-être par la poussière que soulèvent lesdits coups de talons- à retrousser leurs jupes jusqu’à la taille, offrant ce faisant à tout observateur perspicace des visions de l’ombre arborescente qui couvre avec un attrait non pareil leur délectable pubis.
On connaît des versions plus civiles de cette apothéose en Amérique du Sud, où le sens de la mesure et l’absence de fond barbare conduisent les dames à s’abstenir de montrer leurs poitrines, leurs fesses et leur chaton velu, et les hommes à renoncer au rite de la culotte arrachée; pour accompagner leurs coups de talons, ils se contentent d’agiter en l’air un mouchoir blanc, généralement propre mais à l’occasion décoré de sécrétions nasales ou de taches de vin rouge.
(publié dans le Canard Folk d’avril 2002)

